 L’existence d’une classe dominante détenant le pouvoir réel détruisant le lien social comme l’écosystème est un fait. Mais pourquoi la puissance des financiers et techniciens s’impose à une majorité de citoyens alors qu’ils n’en représentent qu’une infime minorité ? La « compétition solitaire » généralisée est-elle à ce point jouissive pour être anesthésiante et préférable à la « coopération solidaire » ? Pourquoi la pauvreté persiste t-elle voire s’aggrave alors que la richesse ne cesse de s’accroître ? Le dérèglement climatique et le tarissement des ressources ne sont-ils pas aussi les témoins de la destruction de notre espace vital ? Le développement humain n’est-il pas à opposer au PIB indicateur d’accumulation de la valeur monétaire ? Consécutivement la croissance actuelle est-elle vraiment synonyme de progrès ? Comment le capitalisme dans son effondrement permanent parvient-il néanmoins à survivre ? Comment le néolibéralisme procède t-il pour annihiler les résistances collectives ? Au-delà du système économique (libéral ou étatique) n’est-il en fait pas question de démocratie ? Comment lutter contre le délitement contemporain et réunir ce qui est épars ?
L’existence d’une classe dominante détenant le pouvoir réel détruisant le lien social comme l’écosystème est un fait. Mais pourquoi la puissance des financiers et techniciens s’impose à une majorité de citoyens alors qu’ils n’en représentent qu’une infime minorité ? La « compétition solitaire » généralisée est-elle à ce point jouissive pour être anesthésiante et préférable à la « coopération solidaire » ? Pourquoi la pauvreté persiste t-elle voire s’aggrave alors que la richesse ne cesse de s’accroître ? Le dérèglement climatique et le tarissement des ressources ne sont-ils pas aussi les témoins de la destruction de notre espace vital ? Le développement humain n’est-il pas à opposer au PIB indicateur d’accumulation de la valeur monétaire ? Consécutivement la croissance actuelle est-elle vraiment synonyme de progrès ? Comment le capitalisme dans son effondrement permanent parvient-il néanmoins à survivre ? Comment le néolibéralisme procède t-il pour annihiler les résistances collectives ? Au-delà du système économique (libéral ou étatique) n’est-il en fait pas question de démocratie ? Comment lutter contre le délitement contemporain et réunir ce qui est épars ?
La réflexion portée à l’étude des Loges sur la décroissance a permis de faire quelques constats sur la croissance actuelle, et de remettre an cause quelques idées reçues.
I. Croissance, constats et idées reçues
I.1 Le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous, slogan ?
Le niveau de consommation des pays du Nord est inégalitaire vis-à-vis des pays du Sud et des générations futures. L’inégalité écologique ne peut être découplée du consumérisme, des systèmes qui organisent le goût du profit et des besoins. Les institutions normalement produites par les citoyens lorsque soumises aux systèmes économiques sont alors détruites par ces derniers puisque devenant alors un obstacle à leur expansionnisme. Il faut donc penser le progrès pour tous et non pas seulement pour quelques uns et la régression pour tous les autres : le coût social doit être pris en considération : les prouesses médicales sont elles souhaitables si accessibles à un petit nombre et si les plus démunis ne peuvent avoir accès à l’essentiel. A quoi sert-il de repousser l’espérance de vie pour quelques uns si le plus grand nombre à l’âge adulte ne peut avoir accès aux soins dentaires et vit dans des conditions déshumanisantes ? Le progrès ne se peut s’il s’accompagne d’une hiérarchisation dans l’accès aux services pas plus que s’il aboutit à une confiscation de la gestion de l’activité sociale par un petit groupe, le citoyen devant pouvoir conserver sa capacité d’expertise. Le sentiment de plus en plus grand de ne pouvoir réellement peser sur la vie de la cité dans lequel se trouvent les électeurs, résulte des alternances sans alternatives, et se trouve être l’une des conséquences de l’individualisme. Car la crise du politique ne révèle pas l’impuissance de nos élus mais notre consternation face à leur renoncement : il se contente de gérer localement les retombés d’une soi-disant nécessité historique mondiale. Mais il n’y a pas de fatalité, et la réversibilité est possible si nous la voulons.
I.2 De la gratuité facteur d’émancipation
A l’évidence la politique des Chicago Boys a des limites. L’écologie politique en France avec les Verts ou Europe Écologie est conforme au capitalisme. Plutôt que la pédagogie de la critique de la société industrielle, elle a cherché à être respectable en restreignant son message à l’éco fiscalité, aux comportements individuels, à la « bobo » attitude socialement injuste puisque c’est ainsi qu’à Londres et Stockholm les péages urbains ont vidé les rues des voitures des plus pauvres pour que les riches puissent y circuler plus rapidement. La gratuité des transports en commun était une autre solution possible, mais l’heure ne semble pas au développement d’une sphère publique gratuite mais bien à la multiplication des espaces privés payants. Le capitalisme d’antan était structuré autour de la défense de la propriété privée, son interdit était donc le vol, pour le libéralisme la gratuité doit être proscrite au profit du secteur marchand : une société s’analyse aussi au travers de ce qu’elle considère comme sacré et profane. La croissance de l’économie financiarisée n’offre pas d’autres perspectives que l’accroissement des inégalités et des spéculations : les crises financières ne sont-elles pas de plus en plus fréquentes ? Lorsque les droites classiques dénoncent la modernité, elles ne souhaitent en réalité que vanter le repli identitaire. En évaluant la qualité émancipatrice d’un mode de vie il est donc possible ne pas être soumis au diktat de la modernité techno marchande sans pour autant sombrer dans le repli et le relativisme culturel. Pourquoi en connaîtrions-nous aujourd’hui plus sur les nanotechnologies qu’hier sur l’amiante ? Le contrôle démographique peut – lui aussi – être vécu comme une contrainte, et une « réaction » : politique de l’enfant unique, épidémie, ou fermeture des frontières, mais aussi comme une émancipation par rapport à la tutelle religieuse lorsqu’il est auto organisé comme le mouvement du planning familial.
I.3 De l’universel et de l’impérialisme
Notre développement pour ne pas engendrer un choc Nord-Sud doit permettre à chacun d’obtenir sa part de bénéfices économiques dans le respect du principe des responsabilités communes mais différenciées : les pays développés le sont car leur développement envisagé à l’aune du profit s’est opéré à la condition du sous développement des pays pauvres. Les premiers ont aujourd’hui une dette envers les seconds.
Plutôt que d’essayer de trouver dans d’autres cultures et d’autres pays les moyens de poursuivre notre mode de vie, (les firmes pharmaceutiques s’intéressent aux savoirs autochtones : phyto-pharmacopée), ne pourrait-on pas trouver dans d’autres cultures des éléments pour imaginer d’autres modes de vie ? La décroissance ne doit elle pas être en fait celle des prétentions à l’universel de l’occident ? Ne plus se considérer comme extérieur à. C’est la différenciation sociale qui donne lieu à la division croissante y compris dans le travail. Pourtant les corps de spécialistes sont présentés comme une évolution dite incontournable, automatique, anonyme. Il n’y a pas de modèle de croissance universel.
I.4 De la nécessité de définir le mieux vivre
La finalité du productivisme est le gain de temps, mais l’ensemble des effets secondaires des échanges privés inscrits dans cette finalité ont un coût pour la collectivité : Le TGV permet certes de relier Paris et Lyon en 2h, mais au prix de la disparition des TER, des trains de proximité. Une autre aberration illustrant ce modèle : la grande distribution : les système locaux fondés sur le commerce de proximité nécessite moins d’efforts et d’énergie.
Ainsi la croissance n’est pas forcément synonyme de mieux vivre pas plus que de bonheur. L’emprunte écologique : espace nécessaire pour une population pour satisfaire à ses besoins et les recycler – est accrue par la croissance. Elle va de paire avec le consumérisme encouragé par l’un de ses vecteurs : la publicité. Se vêtir d’un vêtement de marque, ressembler à, apparaît pour les jeunes des banlieues comme un facteur d’inclusion, tandis qu’il ne contribue en fait qu’à l’exclusion car si les plus démunis aspirent à plus, quels sont les riches qui envisagent de moins avoir ? Si l’on retranche du PIB la valorisation monétaire des activités de réparation des dégâts du progrès alors on constate un décrochage de plus en plus important entre croissance économique et bien être caractérisable par l’espérance de vie, la scolarisation, le nombre de détenus, etc.. La patronne du Medef, reconvertie en grande prêtresse du capitalisme vert, ne dit pas autre chose : « Si peu de croissance pollue, beaucoup dépollue » affirme t-elle, continuons donc de détruire les écosystèmes. Il y a donc bien deux visions qui s’opposent : celle qui considère la grippe porcine comme une pandémie naturelle, et celle qui voit en elle la conséquence de l’industrialisation de l’élevage ; celle qui souhaite marchandiser l’écologie avec la monnaie carbone qui institue le droit de polluer en échange de la plantation d’arbres ou autres compensations, mais nous renvoyant ainsi aux indulgences qui permettaient aux catholiques de racheter leurs péchés.
I.5 Des fausses équations
La croissance de l’économie marchande n’est pas nécessairement synonyme d’emplois. En effet depuis 1950 soit 60 ans tandis que le PIB a été multiplié par sept, le nombre d’actifs occupés n’a augmenté que d’un tiers malgré la réduction du temps de travail légal et la multiplication des temps partiels qui la plupart du temps ne sont pas choisis mais correspondent à une dégradation de l’emploi.
Les entreprises cherchent à gagner en compétitivité et le peuvent par la diminution du prix de revient unitaire des marchandises c’est-à-dire des matière et main d’œuvre qui les composent. Mais la destruction d’emplois serait compensée par la création de nouvelles richesses et de nouveaux emplois : Effet dit de « déversement ». Toutefois la dynamique de l’économie marchande repose sur l’augmentation du taux de profit, mais à mesure que la capital productif (les machines mises en place pour augmenter la productivité) accumulé augmente, le rapport des profits au total du capital diminue. Autrefois l’économie marchande se régulait par des crises : guerres, dévaluation, faillites, lesquelles n’étaient donc pas des ruptures mais des phases du cycle de croissance. Aujourd’hui la suraccumulation est telle que la purge ne pourrait être que d’une violence sociale inouïe. C’est pourquoi les bulles spéculatives se sont multipliées : immobilière, nouvelles technologies mais sans aucun service et emploi produit, ce qui a donc été produit n’est rien d’autre qu’une masse d’argent fictive. Face au dernier krach de l’économie marchande en date de 2008, les états ont joué le rôle d’amortisseur d’insurrection sociale en injectant massivement de l’argent dans le système, ils ont injecté des milliers de milliards d’euros sans grands problèmes (à titre de comparaison l’impôt direct en rapporte 314 milliards), mais toutefois en empruntant et la dette publique sert désormais à justifier le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux. La croissance de la productivité induit elle-même une réduction des emplois. Pour retrouver le plein emploi dans notre système actuel il faudrait une réduction massive du temps de travail à 20/25h, ce qui implique une augmentation mécaniques des salaires et une baisse des profits.
II. Comment donc sortir du règne de l’économisme et redonner un sens à la politique ?
On ne s’interroge hélas pas assez sur les fondements des discours politiques. Pourtant de l’existence de l’individu par lui-même découle le productivisme et le consumérisme.
II.1 De la crise sociale et du rôle des politiques
S’il y a une certaine incrédulité voire défiance à l’égard des partis politiques, on ne peut pour autant occulter l’engouement vers d’autres formes de militantisme ou réseaux de solidarité.
La politique est apparue impuissante face à la montée des inégalités puis à l’image de la compétition entre les individus, elle n’a rien fait pour éviter une compétition entre les nations. La plupart des gouvernements ont obéi à la même loi de la libre concurrence et de la compétitivité. Les relations étrangères de nos pays sont à l’image de nos solidarités nationales guidées par de sordides calculs géopolitiques : ressources pétrolières, guerres de propagande.
Les peurs ont vaincu le politique : insécurité économique et sociale, puis internationale, enfin sanitaire. Face à toutes ces incertitudes la seule garantie est l’existence d’une autorité soucieuse de l’intérêt général. Pourtant dans nos pays industrialisés la société n’est plus perçue comme un rempart contre ces incertitudes mais comme en étant la source. La réponse – déjà évoquée – des démocraties face à la première grande crise sociale ne fut-elle pas la guerre ? Sa réponse aujourd’hui n’est-elle en fait pas la guerre économique mondialisée au travers du libre-échange et de la dérégulation ? Car si au lendemain de 1945, les économies ont été mises à l’abri d’un krach destructeur, rien à été fait pour favoriser le partage des richesses en empêcher la dissolution de la société. Personne ne peut croire à l’impuissance du politique dans un pays riche. Jamais les nations n’ont été aussi riches, les citoyens informés et les choix économiques aussi retreints. La démocratie ne pourra livrer toutes ses promesses que dans un ré engagement collectif. Il ne s’agit donc pas d’inventer de nouveaux outils mais de ré explorer ceux que nous avons délaissés.
II.2 De l’inversion des effets et des causes
L’idée d’un pouvoir économique imposant au politique une dérégulation est une idée fausse : la guerre économique n’est pas une cause de la dérégulation mais en est l’effet. Répandre pendant plus de trente années l’idée d’une inéluctable impuissance politique ne fait que poser les fondements culturels du renoncement de la puissance politique. La mondialisation que nous connaissons n’est en effet pas la première et n’a rien de spécifique à notre époque. Entre 1870 et 1914 un phénomène analogue se produit tandis qu’à l’époque les états naissants ne disposent pas de moyens d’intervention. Et cette évolution finira par susciter ces derniers qui seront institutionnalisés dans les années 1940. Cette première mondialisation s’opère en même temps que le développement du syndicalisme, la naissance du code du travail et de l’impôt progressif. La seconde s’accompagnera, elle, du recul des souverainetés nationales, et des droits sociaux. Pourquoi donc l’état devient-il moins protecteur lorsque les insécurités se multiplient ? L’idée communément admise servant de « tarte à la crème » met en avant la dimension nationale des décisions politiques tandis que les acteurs économiques disposent d’un terrain de jeu étendu à l’ensemble des territoires et peuvent ainsi les mettre en concurrence entre eux. Mais encore une fois la dérégulation apparaît une nouvelle fois comme un effet et non la cause. Il a donc fallu que quelques pays renoncent à la régulation pour enclencher le mouvement et entraîner les autres dans leur sillon. Au début du XXème siècle la crainte du communisme favorise la progression des salaires et des droits sociaux, aujourd’hui la menace permanente du chômage, permet la dégradation des conditions de travail pour les salariés et la multiplication d’exonérations fiscales de la part des gouvernants. L’augmentation du nombre de chômeurs est également la conséquence du choix fait de favoriser dans une politique de désinflation l’épargne des rentiers plutôt que les salaires. Il n’y a plus de conflits pour la répartition de la valeur ajoutée, le capital avec l’aide des politiques gouvernementales successives a gagné. Dans son nouvel âge patrimonial le capitalisme exige une rentabilité annuelle de 15%, lorsque les trente glorieuses n’en permettaient que 5%. Il en découle deux nouvelles notions : celle de l’obligation d’objectifs pour les salariés en lieu et place du temps de présence, et celle l’obsolescence des produits.
La fusion des marchés et des certaines activités comme par exemple banque et assurance permet une redistribution permanente des capitaux vers les activités immédiatement rentables : la lutte conte le SIDA ou pour l’accès pour tous à une eau potable ne sont pas prioritaires. Nous savons de surcroît avec l’affaire Enro/Andersen consulting que des comptes faux peuvent néanmoins être certifiés. L’élargissement du marché financier permet aux grandes entreprises le recours à l’épargne mondiale plutôt qu’aux prêts bancaires plus coûteux et qui le sont encore plus pour les pays en voie de développement. Ces derniers sont sommés par le FMI de se rendre attrayants aux investisseurs en échange de son soutien financier : il n’y a donc pas de transfert de richesses des pays riches vers les moins développés : Oublions donc la redistribution de la dette ! Pourtant l’histoire montre que le libéralisme ne permet pas aux pays en voie de développement de sortir de la pauvreté au contraire d’un volontarisme et donc d’une certaine forme de dirigisme. Les États-Unis eux-mêmes ne pratiquent pas le monétarisme européen, ils n’allouent certes presque aucune subvention aux individus pourtant livrés à la flexibilité mais injectent en revanche massivement des liquidités dans leurs entreprises.
Le néolibéralisme colonise donc la planète à plus d’un titre. La déroute idéologique est totale : ré-émergence des partis de droite extrême, et les catastrophes sanitaires connues : n’a-t-on pas voulu transformer des herbivores en carnivores ex : la vache folle, déforestation, nappes phréatiques, épuisement des sols, trous dans la couche d’ozone etc… Il ne s’agit pas de replacer l’économie sous le contrôle des politiques, elle l’est déjà mais de faire en sorte que le politique soit au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale et ne soit plus à la solde des capitaux privés, et de l’individualisme.
II.3 De guerres en guerres
Le déliement des liens sociaux constitue donc à la fois la conséquence et la condition à la compétition généralisée. Pour preuve qu’il n’y a pas eu désengagement de l’État, les dépenses publiques et prélèvements obligatoires ont augmenté mais ils se répartissent différemment. Les budgets alloués à l’éducation ou à la santé sont en baisse tandis que ceux dédiés à des mesures policières en hausse. On établit un bouclier fiscal pour les plus riches, à charge aux pauvres de payer chaque service au prix fort. Il s’agit de privatiser l’individu de sorte que l’ensemble du vocabulaire lié à une quelconque forme de socialisation lui devienne étranger : l’impôt, la cotisation, etc.…dont les baisses permettent de creuser volontairement les déficits pour justifier la réduction du nombre de lits ou des effectifs d’enseignants puis les privatisations. Il s’agit bien d’une bataille culturelle : faire passer les opposants à la marchéisation pour des passéistes. En s’interdisant toute harmonisation fiscale et sociale, l’Europe favorise la compétition de territoires en son propre sein. L’intérêt général lui est étranger. (Nationalisme). Nous avons pu voir qu’il y avait également associé à l’idéologie néolibérale un discours dit « dominant »: le « bouclier fiscal » indique qu’il faudrait se protéger d’une fiscalité jugée ainsi dangereuse, on parle aussi de « gouvernance », il faut y entendre des agences privées et décentralisées de régulation. Le champ d’intervention de la loi doit être un champ d’exception. Les néolibéraux parlent de la libre circulation des biens et des personnes. Nous savons qu’il s’agit par ailleurs plutôt de celle des biens. La possibilité d’un fait, et le fait même sont confondus, et la confusion mobilité/liberté est entretenue. De la même manière le TCE instituait le droit de travailler différent du droit au travail. La montée des inégalités et l’exclusion sociale engendrant la violence, l’État policier se trouve ainsi faussement justifié. Lorsque qu’une société ne se conçoit plus comme un projet collectif, le rejet du « vivre ensemble » est inéluctable, l’école privée de ses moyens devient un lieu de reproduction des inégalités. Et les incivilités contre les valeurs collectives officielles mais abstraites puisque irréelles se multiplient alors en même temps que prolifèrent les communautés avec certes leurs propres valeurs, mais plus effectives. Transposé au niveau international cette politique n’a pas d’autres finalités que le choc des civilisations : Nord contre Sud, Jihad contre croisade. Tout comme la guerre économique, les guerres préventives aux intérêts à peine voilés, servent à entretenir un sentiment d’insécurité. A l’échelle intérieure d’un coté de l’Atlantique l’exclusion se traduit par un taux d’incarcération inégalé des plus défavorisés (55% des 20-35 ans noirs) et de l’autre coté par un taux de chômage élevé pour les mêmes classes (CV anonyme). Dans un tel état de violence, la surconsommation apparaît le plus souvent comme un anxiolytique.
État néocolonialiste et policier et médias mis au pas ne constituent-ils pas un préambule pour un régime de type fasciste ? A part cela les échanges commerciaux garantissent, paraît-il, la paix. La responsabilité individuelle ne permet-elle pas d’exonérer la société ? Jérôme Kerviel n’est-il pas un bouc-émissaire ? Peut-on promouvoir des normes sociales et environnementales en même temps que le culte du productivisme et des profits ?
II.4 La différentes formes de société face à celle du progrès humain
Dans une société de progrès humain il y a conciliation des aspirations égoïstes et altruistes, la « dissociété » créé les conditions pour que l’ « être soi » atrophie l’ « être avec », tandis que l’hyper société fait l’inverse. La « dissocitété » relève donc d’un processus de dis-association de la société : il ne s’agit plus de vivre « avec » mais plutôt « à coté de ». Cette dissolution se traduit par le communautarisme d’abord inter-communautaire, puis intra-communautaire, enfin intra-personelle : l’individu n’étant plus capable de la nécessaire conciliation des ses aspirations contradictoires.
Plus que d’échanges, c’est de liens dont nous avons besoins : nous pleurons nos proches mais jamais nos biens. (Liaison avec les autres donc mais aussi de nos deux aspirations ontogénétiques – le processus du lien nous inscrit dans une dynamique).
II.5 De la conciliation de nos aspirations
Le discours néolibéral repose sur la conception de l’homme compétiteur au rebours de l’homme solidaire. L’homme serait par nature égoïste et l’homme prédateur aurait fait ses preuves face au « socialisme réel » qui nous sert à caractériser les anciens régimes des pays Est-européens. Il n’y a pas d’autres voies possibles. Toutefois la réussite dépend avant tout des objectifs sociaux fixés (quels indicateurs donc ?) et de leur hiérarchisation, et la société doit s’évaluer au travers de son propre idéal et non de l’idéal contraire. Pourquoi le productivisme serait-il meilleur dans une « dis-société » que dans une « hyper-société » ? Précisions qu’il n’a jamais été l’idéal de certaines sociétés primitives qui n’ont donc rien entrepris au-delà de ce qui leur était nécessaire, mais pourtant encore existantes.
Pour le néolibéralisme : l’individu est égoïste et autodéterminé. L’être humain est isolable de ses semblables alors que notre vision maçonnique tend plutôt à nous faire considérer l’univers comme indivis ? La loi est considérée par la société productiviste comme un mal qui lui est nécessaire, laquelle société n’existe que pour vivre et non pour être, et permettra dans l’abondance matérielle l’éradication des conflits et d’éventuelles lois. Il y a des inégalités de fait mais les inégalités sociales n’existent pas, l’individu étant seul responsable de sa situation : Ex de rhétorique : Les chômeurs le sont parce qu’ils le veulent bien. Dans cette atomisation de la société en individus le seul moyen d’éviter les conflits permanents apparaît être l’anéantissement de ces autonomies dans la « dissociété » et ses communautés ou dans un tout totalitaire, éliminant les pierres humaines parfois rugueuses. La pression communautaire véritable conditionnement social permet d’externaliser la loi en l’éradiquant au profit de règles : l’individu finit par internaliser des normes propres à la communauté, dans une société de consommation dédiée à la production, l’anticonformisme n’est donc pas de mise : il faut dit-on avancer, accepter la réalité, et agir en conséquence. Seul le « socialisme méthodologique » permet la conciliation de l’ « être soi » et l’ « être avec », de l’individualité et du « vivre ensemble », de l’abondance des liens librement consentis plutôt que celle des biens assujettissants. Les prises en compte conjointes de l’essence sociale de l’être humain et des contraintes écologiques peuvent seules nous permettre de dépasser la logique de compensation des dégâts sociaux. Il s’agit donc de concilier en chacun de nous l’ « être égoïste » et l’ « être altruiste », de permettre l’altérité mais aussi de nous concevoir comme faisant partie d’un tout que nous devons faire tendre vers un avenir que nous choisissons en évitant l’écueil de l’écologie radicale en même temps que celle labellisée développement durable, servant à valider notre modèle de développement actuel.
II.6 D’une hyper adaptation à une autre, des origines de l’homme
16 millions d’année les hominoïdes depuis le berceau africain gagnent l’Europe puis l’Asie.
Entre 14 et 4 millions d’années les hominoïdes africains donnent naissance aux hominidés qui se subdivisent en deux familles les paninés et les homininés. Les premiers sont les grands singes et des seconds sont issus les australopithèques qui disparaissent autour de 2,5 millions d’années (?).
Enfin autour de 2 millions d’années naît Homo Ergaster (Afrique) duquel est issu Homo Erectus (Asie) puis plus tard il y a 300 000 ans Homo sapiens (Europe) puis entre 70 et 30 000 ans Sapiens sapiens. Les paninés qui restent dans la forêt ou aux abords de celle-ci n’évolueront pas. Une espèce hyper adaptée à un écosystème ne l’est en revanche pas à des éventuels changements radicaux de ce dernier. Les homininés compenseront cette hyper adaptation par celle aux relations sociales. La bipédie entraîne de nombreuses évolutions morphologiques qui nécessiteront et/ou permettront l’intensification du lien d’attachement aux autres : la perte des pieds préhensiles, le retournement du nouveau né à venir dans le ventre de sa mère, l’iris de l’œil entouré de blanc, le larynx et le cerveau. Le développement des relations a rendu le langage indispensable. Le cerveau humain preuve de son caractère social est le seul qui continue de croître au-delà de la naissance.
Puis il y a 10 000 ans nous assistons à une spectaculaire mutation culturelle de l’homme avec sa sédentarisation et l’agriculture (Rôle de la ritualité). La compétition n’a donc rien de naturelle chez l’homme pas plus que dans la jungle comme cela est couramment répandu. L’homme ne peut être lui-même que dans la mesure où son identité propre a pu se construire grâce et avec les autres, donc dans un environnement social paisible la permettant (Milgram et autres expériences).
Le seul fait d’être un survivant ne peut donc nous suffire car la solitude n’existe pas. Nous ne sommes plus rien dans la parfaite similitude : les traits personnels de la communauté deviennent de plus en plus exclusifs. De la naissance à l’âge adulte l’homme ne cesse de multiplier ses cercles de relations jusque dans le concept lui permettant un lien avec des personnes qu’il ne connaît pas : la communauté symbolique comme par exemple la République. L’émancipation lui permet de grandir, par analogie le communautarisme constitue une amputation de l’être dans la restriction sans fin de ses relations.
Conclusion
Le capitalisme allié du productivisme en fabriquant un mode de vie dépoétisé, dé symbolisé, désincarné, et désinstitutionnalisé fabrique un homme nouveau dépourvu de sa condition humaine, ceci sans même prendre en considération l’accès désormais possible à la nature même de l’homme (clonage – gênes). Il faut donc ne pas sombrer dans l’hétéronomie (état de la volonté qui puise hors d’elle-même le principe de son action, qui impute à un autre ses institutions et qui s’interdit de les changer) propre aux ordres religieux. Respectons la chronobiologie (culture hors sol) et par la même l’espace géographique (aménagement du territoire contre urbanisme), cessons d’être consommateur pour redevenir citoyen doué de culture, capable de réflexions critiques sur ce qui est présenté comme l’inéluctable modernité, déterminons les biens et services à garantir gratuitement (santé, école, cantine, culture, etc.…) à chacun en nous appuyant sur leur empreinte écologique.
Refusons de travailler plus. Faisant le constat que l’individualisme conduit au désintérêt de la chose publique, dans « De la démocratie en Amérique » Tocqueville suggère que « la dégradation des passions civiles fait le lit d’un despotisme qui pour n’être pas toujours violent, n’en dégrade pas moins la liberté et la dignité humaines ». Notre temps libre devrait au contraire permettre l’émancipation. Il ne s’agit pas d’être technophobe ni technophile mais d’être contre ce qui favorise toute forme de concentration, de capitalisation au détriment du débat public. Un alter mode de vie se doit de régénérer l’espace public, la réduction du temps de travail permettant outre le fait de dépasser le productivisme, permet de libérer le temps nécessaire au débat.
Partageons plus puisque 5% de la richesse des 250 plus riches permettraient de couvrir les besoins fondamentaux de tous. Garantissons donc à tous un revenu inconditionnel dont une partie pourrait être versé sous formes de biens collectifs garantis (volume d’eau, niveau de température, possibilité de se déplacer), établissons un revenu maximum….possibles premiers pas sur le chemin de la dissidence.
Avec la possibilité des altérités et la défense de leur indispensable égalité, basculons dans la société du temps libre et du lien social.
Pour résister la resocialisation apparaît avant tout comme un combat culturel. Elle permettra de ré-élaborer une alternative politique ou d’imposer des changements même lorsqu’ils ne sont pas proposés. Les discours sont des actes, c’est pourquoi il faut s’emparer du débat, du forum, lieu s’il en est du combat des idées et donc de la bataille culturelle.
Pour influer sur la politique, une autre solution s’y engager.
Bibliographie :
La décroissance : 10 questions pour comprendre et en débattre – La découverte
Liberté Égalité Gratuité – Golias
La simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance – Paul Ariès – La découverte
La dissociété – Jacques Généreux – Points



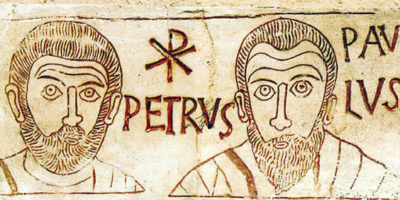
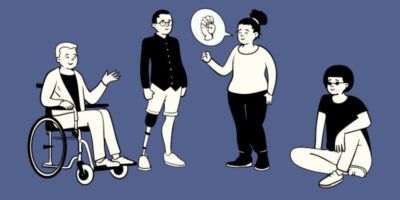

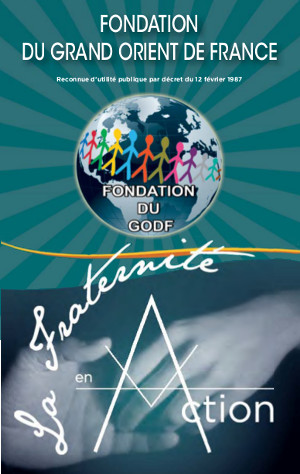

Leave a Reply