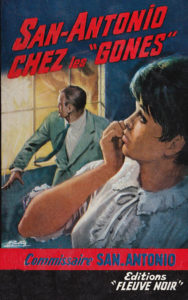 En ce dimanche, j’avais envie de partager avec vous le plaisir qui est le mien de parcourir régulièrement les textes de cet écrivain singulier qu’est Frédéric Dard. Cette histoire remonte pour ce qui me concerne à 1996. Je pars avec mon père à Las Vegas pour voir un concert de Johnny, et à l’époque il n’y avait pas de petits écrans incorporés dans le siège de devant qui vous garantissait de pouvoir choisir vos distractions. Alors avant d’embarquer, et pour éviter de trop longues heures d’ennui, nous pénétrons mon père et moi dans un Relais H. Mon père me tend alors un livre en me disant « Tu devrais lire ça, je le lisais quand j’étais jeune ». Et il me tend mon premier San Antonio. Sans pouvoir expliquer pourquoi, ce livre me parle immédiatement, je le comprends sans rencontrer la moindre difficulté pour décrypter cet argot si particulier. Et surtout je me mets à prendre des fous rires dans l’avion, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi.
En ce dimanche, j’avais envie de partager avec vous le plaisir qui est le mien de parcourir régulièrement les textes de cet écrivain singulier qu’est Frédéric Dard. Cette histoire remonte pour ce qui me concerne à 1996. Je pars avec mon père à Las Vegas pour voir un concert de Johnny, et à l’époque il n’y avait pas de petits écrans incorporés dans le siège de devant qui vous garantissait de pouvoir choisir vos distractions. Alors avant d’embarquer, et pour éviter de trop longues heures d’ennui, nous pénétrons mon père et moi dans un Relais H. Mon père me tend alors un livre en me disant « Tu devrais lire ça, je le lisais quand j’étais jeune ». Et il me tend mon premier San Antonio. Sans pouvoir expliquer pourquoi, ce livre me parle immédiatement, je le comprends sans rencontrer la moindre difficulté pour décrypter cet argot si particulier. Et surtout je me mets à prendre des fous rires dans l’avion, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi.
J’avais donc envie de vous en dire un peu plus sur l’histoire de cet homme que l’on connaît finalement assez peu, et surtout partager avec vous le fait qu’il est selon moi un véritable artiste, un écrivain dans le sens le plus large du terme. Bien que longtemps regardé avec un certain dédain, il ne faut pas à mon sens s’arrêter aux calembours douteux ou aux évocations érotiques permanentes, et reconnaître qu’il a su, tel un Céline, un Hugo, ou un Flaubert, développer un style, une manière d’écrire, qui relève bel et bien de la création artistique.
Quelques exemples
S’habiller en engrais azoté : mourir
Une détronche : décapitation : « il avoue tout ce qu’on veut et il se retrouve dans le quartier des condamnés à la détronche un vilain matin »
Modestiser : se montrer humble : « il modestise des yeux et des épaules »
D’artagner : agir de façon chevaleresque
Chairedepouler : avoir la chair de poule « Ma peau se met à chairdepouler pire qu’un mur crépi ».
Le boulevard des allongés : le cimetière
J’ai choisi d’intituler cette planche San Antonio malgré lui car il est remarquable de constater que malgré le succès, il n’a jamais été l’écrivain dont il rêvait. Lui qui se voyait Lauréat du Goncourt, il a connu surtout la reconnaissance populaire. Je n’ai pas de chiffres précis et récents, mais on peut assurer qu’il a vendu plus de 250 millions de livres. Il est surtout un homme d’une très grande timidité qui fonctionne toute sa vie par la dissimulation : il dissimule son handicap, il se dissimule derrière des pseudonymes, San Antonio n’en étant qu’un parmi beaucoup d’autres, il dissimule sa liaison extraconjugale, il se cache en Suisse, et, comble de l’écrivain, pour ne pas avoir à subir de plein fouet le regard sévère des critiques littéraires, il me semble qu’il dissimule son talent littéraire derrière un humour grivois, franchouillard, et souvent un peu gras. Autrement dit, en n’écrivant que des romans policiers sur un ton humoristiques, en dénigrant lui-même ses propres romans, il évite le risque de se faire viser par les snipers de la littérature, mais par là même nuit à la reconnaissance de la réelle qualité littéraire de sa production.
J’ai construit cette planche en trois temps : un premier temps consacré au parcours de l’homme, un second temps qui évoquera quelques sources de son inspiration, et un troisième temps pour souligner la reconnaissance par la critique de sa qualité de véritable écrivain.
1. Parcours biographique
Frédéric Charles Antoine Dard naît le 29 juin 1921 à Bourgoin-Jallieu dans l’Isère.
Son père dirige une entreprise de chauffage à Bourgoin Jallieu, ce qui assure à la famille des revenus corrects. Ses parents engagent une femme de ménage, Mme Bérurier, dont le mari, ancien marin, est invalide de guerre. Un jour, Frédéric va par hasard chez la femme de ménage et tombe par hasard sur Monsieur, occupé à prendre un bain de pied : il trempe un moignon dans une bassine, sa fausse jambe posée sur une chaise. Qu’on ne cherche pas d’où lui vient l’un de ses personnages principaux.
Avec la crise de 29, l’entreprise paternelle fait faillite et Frédéric assiste au passage des huissiers. LA famille part alors pour Lyon. L’école est pour lui un calvaire. On rêve de le voir devenir comptable, c’est pourquoi il fréquente une école spécialisée. Il s’ennuie à mourir en comptabilité mais comme il a de bons résultats en Français, le professeur le laisse lire tranquillement au fond de la classe. C’est un enfant qui plonge dans la pauvreté, perd tous ses repères, reste extrêmement timide et réservé du fait de son infirmité, j’y reviendrai plus tard, et qui, sous l’influence de sa grand-mère, trouve dans la littérature un véritable exutoire.
Grâce à son oncle, il est présenté à M. GRANCHER, écrivain reconnu et dirigeant du journal Le Mois à Lyon qui l’engage non comme journaliste, mais comme garçon de course. S’il n’écrit pas encore, il fait la connaissance de nombreux journalistes et écrivains, dont certains l’initient à l’argot, mais aussi d’Edmond Locard, criminologue célèbre, avec qui il assiste aux procès d’assises, jouant à se faire peur en reconstituant des histoires sordides alternant horreur et pitié.
Il se met véritablement à l’écriture en 1940, et publie notamment Monsieur JOOS, récompensé du premier Prix Lugdunum qui lui apporte une certaine notoriété.
Pendant la guerre il est mobilisé en tant que dessinateur et chargé de tirer les plans destinés à la fabrication des ailes d’avions. En 1942, il voit une traction s’arrêter devant lui. Un homme de la Gestapo en descend et lui demande de se mettre nu et de lui montrer son sexe… On imagine le traumatisme.
A l’instigation d’amis résistants de Grancher, il ravitaille un vieil homme qui se cache dans une chambre de bonne. Pas véritablement résistant lui-même, il sauve son patron Grancher en le prévenant que des allemands sont venus à son bureau et lui permettant ainsi de prendre le maquis.
Il fait par hasard la connaissance pendant la guerre de Grégory ALEXINSKY, qui fréquente la même brasserie et avec qui il partage le goût de la littérature et des arts. Il découvre qu’il est en fait commissaire de police et résistant. Il rencontre ainsi policiers et malfrats, leurs codes, leur langage.
Dans le roman la Crève en 1946, il fait le récit pathétique des dernières heures de P’tit Louis, jeune milicien lyonnais qui sera exécuté pendant l’épuration. Il ne faut pas sous-estimer les scènes auxquelles il a assisté à cette époque. Il lui est arrivé de tenir la lampe au cours d’une exécution sommaire, avec ses amis corses dans une halle aux poissons transformée en tribunal d’exception.La Crève l’installe aux yeux de la critique comme un romancier sérieux. C’est un livre plein de désespoir alors qu’il n’a que 25 ans.
L’écriture de ses deux premiers romans policiers lui a montré qu’il pouvait écrire vite. Il subviendra ainsi aux besoins de sa famille (il s’est marié en 1942, son fils naît en 1944 et sa fille en 1948) en faisant de l’art mineur, de la littérature alimentaire dans l’attente du grand œuvre… Inspiré par les auteurs de romans noirs américains, notamment par Peter Cheyney, il se lance dans les romans policiers, qui sont le cas échéant des pastiches.
Sur un coup de tête, contrarié par une remarque formulée par Grancher dans son livre de mémoires, il décide de partir à Paris. Il signe avec une nouvelle maison d’édition, Fleuve Noir, où travaille également Michel Audiard, et publie la même année son premier San Antonio « Réglez-lui son compte », qui ne rencontre pas le succès. La légende veut qu’il choisisse le nom de son héros en prenant un atlas et en pointant le doigt, les yeux fermés, sur la ville du Texas. L’originalité de San Antonio, un roman écrit à la première personne, est de confondre personnage et auteur, et lui fait dire par exemple « je commence à en avoir marre de ce roman policier ». Le canard enchaîné émet pourtant une bonne critique : « comparés à ce roman, les héros de Peter CHEYNEY font figure de petites filles modèles. Du bagout, de la bagarre et chez l’auteur une virtuosité telle qu’il finirait par vous rendre sympa un car de brigades centrales ».
C’est plutôt une période de vache maigre, durant laquelle il enchaîne la publication d’histoires courtes et grivoises. Il a une production phénoménale, de 25 à 30 pages par jour. Il est un véritable Stakhanoviste de la production littéraire. Entre les romans à son nom et ceux écrits sous des pseudonymes, on comptabilise pas moins de 288 romans, 20 pièces de théâtre, et 16 adaptations pour le cinéma. Rien que sur l’année 1957, par exemple, il signe 10 romans pour Fleuve Noir, un scénario original pour le cinéma, une adaptation et les dialogues d’un autre film.
C’est justement au théâtre qu’il va rebondir, en créant des pièces pour le Théâtre Grand Guignol, qui se spécialise dans les pièces policières. Sur demande, il écrit en 4 jours une pièce qu’il monte avec Robert Hossein, Les salauds vont en enfer. Il gagne également sa vie avec des collaborations au cinéma. Il continue à publier des romans policiers, mais toujours sur un mode alimentaire. Il écrit lui-même à un ami : « Vous devriez faire une commande ? C’est très rentable l’espionnage entre autres. Le secret ? Une intrigue aux perpétuels rebondissements. Des meurtres, de la cuisse, un style « coup de poing » sans longueurs ni descriptions. C’est un tour de main à prendre. Lorsqu’on l’a chopé, il ne reste plus qu’à pisser de la copie ». Du cynisme à l’état pur, mais qui cache surtout la peur de se confronter à l’intelligentsia littéraire en publiant des romans sérieux.
C’est pourtant grâce à cet art mineur qu’il rencontrera le succès…et la fortune. Il met peu à peu au point sa potion magique, une poursuite haletante et rocambolesque ponctuée d’intermèdes sexuels, de longues digressions, et au tournant des années 60, les ventes se mettent à exploser. Le héros évolue, étant initialement un espion il redevient simple policiers, s’entoure d’autres personnages (Félicie sa mère, Bérurier et Pinaud ses collègues), le style devient plus enlevé et s’oriente définitivement vers la franche rigolade. Les tirages passent à 200 000 exemplaires en 1960, 400 000 à partir de 1966, 800 000 au début des années 70. Les gros volumes, « L’histoire de France vue par San Antonio » et « le standinge selon Bérurier » dépassent le million de ventes.
Mais il n’est pas à ses yeux l’auteur « sérieux » qu’il rêverait d’être, se trouve embarqué dans une aventure commerciale dont il a un peu honte, et cela le plonge dans une profonde dépression. Il écrit dans « Passez-moi la Joconde » : « Ma vraie vocation, c’était d’aligner des trucs de 12 pieds au lieu de flanquer mon pied dans le soubassement de mes contemporains. J’aurais fait rimer les mots qui ne riment pas à grand-chose et qu’on aurait publiés dans des revues hermétiques comme des boîtes de sardines, j’aurais eu mon triomphe, j’aurais appris à m’examiner le nombril dans mon armoire à glace, j’aurais calcé les baronnes. Les vieilles dames m’auraient appelé « Maître » et les jeunes gens « vieux con », bref j’aurais été quelqu’un ». Alain Poiré écrit de lui qu’il « il considérait San Antonio comme une besogne alimentaire ».
Dépression accentuée par des critiques acerbes sur ces dernières créations théâtrales, et par une culpabilité personnelle : il est amoureux d’une autre femme. Françoise de Caro, la fille de son éditeur. La liaison commence vers 1963. Il vit un enfer mélodramatique qui monte crescendo. il est rongé par le remords et la peur de faire souffrir sa femme et ses enfants ; une douleur qui se retrouve dans des titres comme « La mort en laisse » ou « Refaire sa vie » qu’il publie à l’époque. Dépression qui va connaître son point culminant le 28 septembre 1965, après une grosse dispute avec sa femme, et la boisson aidant, il se passe un lasso autour du cou et se jette par-dessus la rambarde de l’escalier. Secouru par sa femme, il reste dans le coma une bonne dizaine d’heure et enchaîne avec une cure de sommeil.
Il finit par quitter sa femme, se remarie en 1969 avec Françoise, adopte un petit tunisien nommé Abdel en 1970, et voit la naissance la même année de sa deuxième fille Joséphine. Il s’installe définitivement en Suisse avec toute sa famille, où il poursuit son immense production littéraire jusqu’à sa mort le 6 juin 2000.
2. Les déséquilibres de l’artiste
J’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer au cours de planches précédentes : plus je m’intéresse à la vie des artistes, plus j’ai le sentiment qu’ils subissent tous des déséquilibres que la création artistique contribue à combler. J’ai décrit jusqu’à présent un auteur fréquemment sujet à des accès de dépression sévère. Et force est de constater que nombreuses sont les sources de déséquilibre. J’en ai déjà cité quelques-unes, les humiliations subies au moment de la faillite de l’entreprise de son père, pendant la guerre, ou encore face à l’intelligentsia qui mettra un long moment à le reconnaître comme un des siens. Mais il me faut citer quelques autres mésaventures qui ont sans doute nourri les meurtrissures et, peut-être, l’inspiration de l’artiste.
Il y a d’abord la famille :
Son grand-père, Séraphin DARD est héritier d’une dynastie de chocolatiers lyonnais dont il dilapide les biens dans la boisson et le libertinage. Epousant par défi une ardéchoise de 17 ans il passe du lit conjugal à celui de sa belle-mère.
Sa femme Claudia finit par demander le divorce. Si Frédéric n’a pas connu son grand-père, nul doute qu’elle lui raconte les errements familiaux, d’autant que le père de Frédéric est lui aussi assez porté sur la boisson, et que l’ambiance familiale est souvent extrêmement tendue. Une grand-mère, qu’il appelle bonne maman, qui tient une place très particulière auprès de lui. Vivant avec les parents de Frédéric, elle l’initie à la littérature et cherche à rattraper avec lui ce qu’elle n’a pas pu vivre avec ses propres enfants qu’elle n’a pas élevés. Mais s’instaure surtout entre eux une relation que je qualifierai à tout le moins de douteuse, voire presque malsaine et quasi amoureuse. Ainsi ils dorment ensemble dans le même lit. Et lorsqu’il rencontre celle qui deviendra sa première épouse, Odette, elle lui fait une véritable crise de jalousie. Le jour de son mariage, elle continue à le supplier de renoncer. Plus tard, elle laissera traîner ostensiblement une photographie de la mariée avec des trous à la place des yeux.
Cette relation particulière est à l’origine du roman La vieille qui marchait dans la mer. L’histoire de Lady M, qui voyage avec un jeune homme et lui demande de dormir avec lui. « Bien que je sois jeune, je sais déjà que notre enfance ne s’éloigne jamais de nous. Il paraît même qu’elle se fait de plus en plus présente et insistante au fur et à mesure qu’on prend de l’âge ».
Deuxième épreuve pour Frédéric Dard, le handicap :
Le 19 juin 1921, le bébé se présente par le siège et l’accouchement s’annonce difficile. La famille étant prise de panique, on court chercher un médecin tandis que le père crie « Sauvez la mère ». On imagine ce que cette histoire, qui a forcément été racontée à Frédéric Dard, peut générer de désordres psychologiques. A la naissance, le bébé a une jambe et un bras déformés. Si la jambe finit par trouver de la mobilité, le bras restera définitivement inerte, malgré les multiples tentatives de la grand-mère, qui n’a de cesse d’essayer de soigner ce bras, par divers massages et autre marabouts.
Ce handicap sera, à l’école, source de multiples humiliations et d’une très profonde solitude. C’est pour sortir de cette solitude qu’il se plonge dans la littérature et développe une capacité d’imagination hors du commun, livrant des histoires à ses camarades de l’école, ou leur racontant des films qu’il n’est jamais allé voir…
Troisième épreuve : les humiliations littéraires
Il me faut ici évoquer sa relation avec le grand, Simenon, l’inventeur du commissaire Maigret, pour qui il voue une profonde admiration. Leur première rencontre se passe à Lyon, sur le quai d’une gare. Apprenant que Simenon est de passage dans la ville pour une conférence, Dard engage la conversation lui dit son admiration et le fait qu’il aimerait aussi écrire. Le maître lui répond de le tenir au courant de ses activités littéraires.
Au moment où Dard monte une petite maison d’édition, il obtient l’autorisation de publier sa conférence à Lyon sous le titre « l’aventure ». Ils restent à partir de là en contact. Ainsi le 7 septembre 1946 Simenon lui écrit du Canada en lui proposant de l’aider à s’installer à Paris. Après avoir lu La Crève, Simenon écrit « il y a quatre ou cinq pages que je voudrais avoir écrites… Merci de la joie que vous m’avez donnée ».
Lorsque Simenon publie « La Neige était sale », un huis clos, Frédéric Dard lui propose de l’adapter au théâtre et Simenon lui donne son accord. Il lui envoie sa pièce début 1949… 10 jours plus tard Simenon lui répond qu’il a réécrit la pièce et vendu les droits en langue anglaise à New York. Il lui propose néanmoins de faire figurer sur la couverture « adaptation de G Simenon et F Dard ». Le 25 février, nouvelle lettre de Simenon pour lui dire que la pièce est entre les mains d’une agence théâtrale à Paris. Dard apprend ensuite que les producteurs envisagent de monter la pièce au seul nom de Simenon, qui fait semblant de lui demander son avis. Mais comment refuser ? En novembre Simenon lui apprend que la pièce est en répétition. Quand Simenon rentre à Paris en 1952, Dard vient d’adapter avec un grand succès une pièce du romancier Carco. Ce dernier accueille Simenon dans une loge du théâtre en lui disant« Je ne te présente pas notre adaptateur commun ». Simenon répond sèchement « je n’ai pas d’adaptateur ». Ce jout-là, Dard rentre chez lui en pleurant.
A la mort de Simenon, Frédéric Dard écrira « La radio annonce que Simenon est mort. Cela faisait plus de 10 ans que je connaissais la nouvelle… Voilà plus de dix ans que je le pleure… Il n’a pas réinventé la vie, il nous l’a simplement, très simplement, montrée. »
J’ai jusqu’à présent évoqué des situations dans lesquelles la vie réelle de F Dard avait pu être une source d’inspiration pour le romancier. Il me faut maintenant évoquer une situation extraordinaire dans laquelle réalité et fiction se confondent. En 1983, il entame un nouveau roman « Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches ? », qui a vocation à être publié sous son nom. C’est l’histoire d’un romancier à succès, nommé Charles Dejallieu, surnommé l’enfant au bras meurtri qui se retire en Suisse, et dont la belle fille Dora est enlevée par des ravisseurs.
En pleine écriture de ce roman, le 23 mars Edouard Bois de Chesne pénètre de nuit au domicile de Frédéric DARD et enlève sa fille Joséphine de 13 ans. Accompagnés par la police, les Dard vont voir un juge d’instruction que les collègues surnomment Béru. Dard finit par livrer la rançon dans une ambiance cinématographique. Fort heureusement la petite fille est retrouvée plus tard. Pour l’anecdote, le ravisseur se fait repérer dans une cabine téléphonique car il porte un masque de Mitterrand, ce qui est assez iconoclaste dans une petite bourgade suisse… Dans le roman, il laisse une page blanche et écrit « C’est à ce point précis de mon livre que l’impensable s’est jeté sur ma vie et que ma propre fille a été kidnappée »
3. Un véritable écrivain
Je souhaite maintenant faire partager l’idée selon laquelle, derrière la dimension populaire, il y a une réelle ambition artistique, une qualité littéraire indéniable dans l’œuvre de Frédéric Dard. Je crois d’ailleurs que l’impossibilité d’adapter son œuvre de façon convaincante au cinéma, malgré de nombreuses tentatives, est une preuve de la dimension purement littéraire de sa production.
Assez tôt, des écrivains installés s’intéressent à son style. J’ai déjà évoqué Simenon, et c’est le cas de Cocteau également qui lui écrit en 1957 : « Je vous aime beaucoup et votre vermotisme est une merveille de grâce. Ne l’abandonnez pas ».
Il connaît d’ailleurs quelques succès critiques pour des romans plus classiques. Il fait notamment une percée remarquée dans le récit politique avec « Y a-t-il un français dans la salle ? », qui se vend à 180 000 exemplaires. Il y fait une description assez grinçante des hommes politiques : « Tout est contrevérité chez ce mec impersonnalisé par la politique. Ces gens, n’importe leur apparence, quand tu les approches, tu tombes toujours sur le même. Depuis longtemps, ils sont vidés d’eux-mêmes et ressemblent à des coquilles d’escargots pleines de terre. Ils se suffisent de leur suffisance, preuve que ces ambitieux se contentent de peu. Tous, je le jure, ont la pareille redondance glorieuse, cette même manière d’être convaincus qu’ils convainquent, qu’ils sont moralement importants et détenteurs d’idées ».
Mais c’est bien évidemment avec le succès populaire qu’apparaît la reconnaissance des critiques, mais aussi de l’Université, avec des travaux de recherche qui s’intéressent à son style inimitable, ses trouvailles langagières incroyables.
Le 6 avril 1963, lors d’un colloque à Bordeaux organisé par Robert Escarpit, éditorialiste au Monde, une première analyse universitaire de l’œuvre est esquissée. Les intervenants soulignent quatre dimensions essentielles de la patte Frédéric Dard :
- Le fait d’emprunter aux argots de toutes sortes : celui des malfrats, de la police, et le langage de la rue. Escarpit écrit « son argot personnel s’élève parfois au niveau d’une véritable création poétique ».
- Le dépaysement que constituent les images employées par l’auteur, qui opèrent un décalage entre le milieu que décrivent les aventures et celui auquel sont empruntées ces images. Il disperse ainsi l’attention du lecteur.
- Les énumérations : description de Mai 68 dans « Viva Bertaga » : « Poulets, les en-civil, les en militaire et les CRS, les gardes de mobile, les indicateurs, les contre indiqués, les sans tractuels, tout ce qui est flic ou enfoiré, tout ce qui tabasse, menotte, matraque, quartiélatine, enfonce, défonce, foule, refoule, défoule, foulicide : tous ceux qui font pleurer d’humiliation, de rage et de gaz lacrymogène »
- Le bagage culturel des romans car la littérature tient le commissaire San Antonio. L’un des intervenants souligne qu’ « il y a en San Antonio quelqu’un qui louche vers la littérature, qui s’en amuse et s’amuse d’ailleurs à faire de la mauvaise littérature ». Tout se passe comme si par complexe il n’osait pas aller jusqu’au bout.
En 1964, l’Académie Rabelais lui décerne un prix pour « Votez Bérurier ». Le journal Le Monde souligne les « envolées céliniennes, les jeux de mots allaisiens, les images renardiennes et une façon de conter qui vaut tous les Pierre Benoît ».
On peut lire en 1966 dans le Magazine Littéraire, un article intitulé San Antonio a du génie qui analyse la construction du personnage et l’objet purement littéraire de l’œuvre, parce que son intérêt est moins l’histoire que l’on raconte que la manière dont on la raconte : « Son immense succès –il est le plus lu des auteurs français- apporte, à ceux qui voient dans les textes modernes la mort de la littérature, le plus cinglant des démentis. Autrefois élément nécessaire au déroulement de l’histoire, « héros » classique rattachant le lecteur à un vraisemblable, le personnage n’a plus aujourd’hui ni histoire, ni chair, il est devenu une combinatoire de mots, un être tout entier littéraire.»
La même année, le supplément littéraire du Monde insiste sur une autre dimension de l’œuvre : « Un roman de San Antonio y est décrit comme un « Autoportrait, presque caricatural, d’un oedipien. Le père est mort durant l’enfance de Sant Antonio, …Autoportrait d’un oedipien inconsolable d’avoir été chassé du Paradis de l’enfance. Ses fantasmes et sa scatologie, comme ceux des enfants, découleront du refus du monde des adultes. Sa fureur jaillie du fond de lui-même, fustige la sottise des hommes, toujours présente et consternante. Sottise et laideur, physique ou morale…ils sont tous des vieillards déjà. »
Cette analyse me semble intéressante en ce qu’elle invite à regarder au-delà des gros mots et des scènes érotiques, même à les considérer comme des paravents qui masquent une tentative artistique que l’auteur se sent tellement illégitime à nous montrer qu’il préfère la discréditer par un calembour douteux.
Dans la même veine, une thèse sur San Antonio est réalisée par Richard Zrehen. Ce dernier évoque les scènes osées des romans de San Antonio en ces termes : « il exhibe les postures et les sensations sous des appellations hautement fantaisistes, parfaitement propres à interdire toute mise en représentation des corps ».
Mais le plus simple est sans doute de laisser la parole à l’auteur lui-même, qui s’essaie parfois à décrire son propre style. Concernant la langue utilisée, il déclare : cette langue calibrée qu’on emploie dans les livres mais pas dans la rue. Puisqu’elle ne se parle plus de la même façon qu’on l’écrit, pourquoi alors s’éreinter à la maintenir dans le corset du classicisme….Je n’ai pas été le premier à faire péter les charnières…il y aura toujours les gens constipés pour brandir le code et les règles de grammaire… Mes néologismes ne sont pas gratuits. Certains dérivent de mots existants pour ramasser la pensée, la simplifier « des gosses turbulent dans la rue…Je me sens flou, mou, barbapapesque »… Et puis il y a les mots ou expressions inventées pour déranger et contraindre le lecteur à traduire « Je tors la grosse chaîne à m’en décamouiller les bagoules »… Je remplace des mots par des sons »
Autre commentaire très intéressant de l’auteur sur la manière dont il crée, se mettant je le rappelle devant sa machine très tôt le matin et pouvant noircir une trentaine de pages par jour : Je commence à écrire une phrase comme un peintre qui prend la couleur au hasard… Je ne me relis pas, ou à peine…Ca se sent… Si je me relisais je mettrais tout à la poubelle. Je note parfois quelques calembours mais les métaphores, c’est comme les agressions, ça vient comme ça… Tu te répètes mais toujours autrement. Magritte a peint 50 portes qui ne donnent sur rien, mais les 50 toiles sont différentes »
Comble des combles, en 1985 San Antonio fait son entrée dans le dictionnaire Larousse, mais pas Frédéric Dard.
Conclusion
Pour conclure cette planche, je dirais quelques mots de la manière dont Frédéric Dard réagit à ce succès populaire, qu’il ne peut s’empêcher de vivre comme une sorte d’imposture, lui qui est en tension permanente entre l’auteur populaire qu’il est devenu et le romancier installé qu’il rêve d’être. Et quand on lui demande s’il n’est pas gêné de vendre plus de livre que Mauriac, il s’en sort par une pirouette en déclarant : « Si quelqu’un doit être gêné c’est le public qui achète mes livres de préférence à ceux de Mauriac… Je me demande si on ne lit pas San Antonio pour se reposer de Mauriac… »
De même, lorsqu’on lui parle du Goncourt, il n’hésite pas à répondre que s’il obtenait ce prix, généralement vendu à 15 000 exemplaires, ses ventes s’effondreraient.
L’histoire de Frédéric Dard est au fond celle d’un incompris, qui ne parviendra jamais à atteindre la respectabilité littéraire de l’establishment, et qui se retrouve malgré lui l’auteur contemporain le plus populaire de France. Cette situation le plonge dans une profonde déprime qui en retour nourrit son abondante production. Même une fois installé dans le paysage et reconnu par les professionnels de la littérature, il estime occuper une place qui ne lui revient pas, ses galons ayant été obtenus sur un champ qu’il considère comme mineur. Mieux, il semble s’acharner à saboter son propre talent en truffant ses romans de passages pseudo-érotiques ou franchouillards, comme pour bien montrer à tout le monde que son œuvre n’est pas respectable. Il agit comme un enfant qui déchire son dessin de peur d’affronter le regard des adultes. Jacques Chancel écrit de lui « On l’avait fait un temps enfant de Rabelais, de Cervantès et de Céline, on le veut maintenant maître d’école alors qu’il est d’évidence du fond de la classe ».
Je laisserai le mot de la fin à Jacques Audiard qui a écrit la phrase qui selon moi cerne le mieux le personnage : « C’est un homme qui transforme sa misère en chanson de salle de garde »



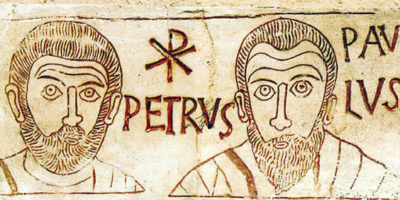
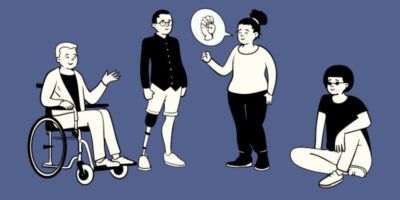

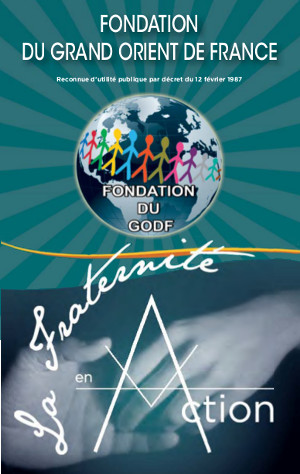

Leave a Reply